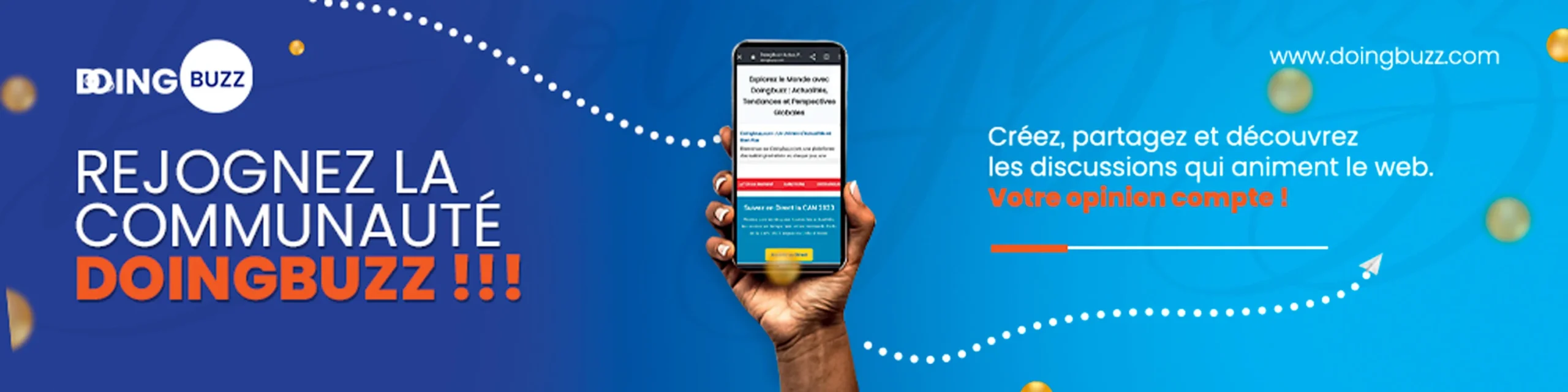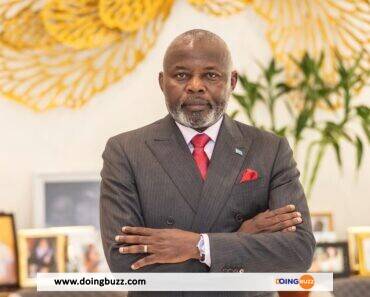« Dans les ruines du futur. » Voilà comment le romancier Don DeLillo décrivait le monde post-11-Septembre, incapable d’imaginer l’avenir. Vingt ans après, avec une intensité décuplée, la pandémie nous lance un même défi. Qui va avoir la main sur le récit de ce qui s’est passé ?
«Il venait d’un endroit qui était tout autant défini par ses coordonnées géographiques, par le revenu moyen de ses habitants, son taux de chômage, que par son absence de récit… », écrit Jakuta Alikavazovic dans son roman L’Avancée de la nuit. Ce livre publié en 2017 peut se lire comme un roman de l’impasse narrative, entre un monde qui finit et un autre qui commence. La couverture du livre, une chambre sans vue mais avec un lit défait, un drap sur son occupant, dos tourné, et un oiseau en attente préfigure les semaines de confinement que nous venons de vivre.
Depuis que le Covid-19 s’est installé parmi nous, nous sommes tous devenus citoyens de cette contrée sans récit, dont les coordonnées géographiques, économiques ou sociales, ont été désorientées, désynchronisées par l’épidémie, un « endroit » à la fois physique et imaginaire, introuvable sur les cartes géographiques, ni le « Monde d’avant » ni le « Monde d’après », mais le « Monde-Sans », un monde sans récit comme un homme qui aurait perdu son ombre…
Ce monde n’est pas tout à fait une terra incognita, il a toujours existé comme une possibilité. Possibilité d’une impossibilité à vrai dire dont la syntaxe témoigne : inénarrable, indescriptible, indicible, ineffable, inracontable. Il se manifeste après chaque grande catastrophe, guerre, tsunami, terrorisme, épidémie. Les grecs le nommaient « anek diegesis », un monde privé de récit.
Nous sommes tous « anekdiegesiens ».
Qu’est-ce qu’un monde sans récit ?
Il n’est pas facile d’en rendre compte, car c’est une dimension cachée qui s’efface, c’est un plan de vision, ou d’audition qui disparaît, une débâcle acoustique. « Il faut se garder de court-circuiter le bouleversement créé par la pandémie, en revenant à des formes de récits antérieures, “conventionnelles”, commente Jakuta Alikavazovic. Si on pense le monde d’après en reprenant les formes, les structures et les conventions de celui d’avant, c’est un peu comme si on refusait l’ébranlement. Nous devons inventer une autre architecture narrative, une forme adaptée à cet entre-deux-mondes, qui se cherche et essaie d’arriver… (et quelque chose arrive bien, d’ailleurs, mais de quel ordre ? C’est toute la question…) »
Depuis le début du XXe siècle nous avons connu trois grandes crises de narration.
La première, analysée par Walter Benjamin, est contemporaine de la Première Guerre mondiale, elle se traduit pas une crise de transmission de l’expérience. Dans son essai Le Raconteur, Benjamin expliquait comment cette « faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes […] l’art de conter est en train de se perdre ». La faculté d’échanger des expériences par le récit régressait selon lui jusqu’à disparaître lorsque l’expérience cessait d’être communicable. « N’avions-nous pas constaté, après l’Armistice, qu’(ils) revenaient muets du front, non pas plus riches, mais plus pauvres en expérience communicable ? »
La deuxième, consécutive de la Seconde Guerre mondiale, est analysée par Theodor Adorno comme la destruction de la continuité temporelle des événements. Adorno pointait une sorte d’arythmie des événements qui rendrait l’expérience impossible à ordonner en récit avec ses périodes et ses séquences. « La vie s’est transformée en une suite intemporelle de chocs entre lesquels il y a des trous béants, des intervalles vides et paralysés », écrivait-il en 1945 pour décrire l’expérience du front lors de la Deuxième Guerre mondiale. Son livre, Minima Moralia, sous-titré « Réflexions sur la vie mutilée », est constitué de 153 fragments comme s’il n’était plus possible de ressaisir en un tout cohérent une expérience privée de toute continuité et livrée à des chocs incessants.
La troisième grande crise de narration a commencé avec le 11-Septembre, s’est prolongée avec la crise des subprimes, et explose aujourd’hui avec l’épidémie du coronavirus. Le philosophe Baptiste Morizot parlait déjà dans son livre Manières d’être vivant, d’une « crise de la sensibilité » : « un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme d’affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui. »
Cette crise n’est pas seulement une crise sanitaire, économique ou politique, c’est une crise anthropologique qui bouleverse nos rapports au temps et à l’espace, entrave ou paralyse notre liberté de mouvement, met le temps à l’arrêt, suspend l’usage des sens et des plaisirs, le toucher, l’odorat, le goût, mais aussi l’écoute et la parole. Elle circonscrit l’espace et le temps de l’expérience. Elle interdit toute rencontre avec l’Autre. Elle isole et enferme. Et expose l’individu à une série de chocs intemporels que ne semble relier aucune logique narrative. Tout ce qui nous arrive depuis le 11-Septembre, terrorisme, catastrophes écologiques, krach boursier, nous lance un même défi narratif.
De littérature, il a été beaucoup question pendant le confinement : des journaux d’écrivain aux pages débats des quotidiens, des pétitions en faveur de la réouverture des librairies aux bibliothèques idéales de la catastrophe, de la mise en ligne gratuite d’ouvrages par les éditeurs à la déferlante sur les réseaux sociaux des grandes marques littéraires, mises à notre portée et customisées… Boccace, Diderot, Defoe, Chateaubriand ont présidé au confinement comme des statues muettes, créditées d’une sagesse immémoriale face à l’explosion de tous les récits.
L’épidémie de coronavirus n’est pas seulement une crise sanitaire, c’est une crise de narration provoquée par le décrochage des récits officiels coupés de l’expérience réelle. Aucune autorité n’est épargnée, ni le pouvoir, ni les médias, ni les experts, ni les épidémiologistes. Toutes les sources d’énonciation sont viciées. La fausse monnaie des mensonges et des rumeurs se répand sur les réseaux sociaux. La confiance dans la valeur référentielle du langage s’affaiblit en même temps que s’estompe le partage du vrai et du faux, de la réalité et de la fiction.
D’où l’appel ambigu du pouvoir et des médias aux écrivains plutôt qu’aux épidémiologistes, à la littérature plutôt qu’à la science, pour recharger la parole publique dévaluée. La littérature est brandie comme une digue capable de contenir la débâcle des mots, un garrot pour stopper l’hémorragie du langage.
La littérature est apparue comme une issue à la crise du langage, une sorte de valeur refuge, l’étalon-or de la crise des discours. De toute part retentit un appel au récit, aussi vague qu’instrumental. La littérature c’est « la bonne à tout faire » des sociétés désorientées : distraire, enseigner, faire sens, créer du lien, voire cimenter la nation ! Quand certains proposent un « commissariat à l’énergie culturelle », d’autres brassent du vent autour du Writer’s Project de Roosevelt.
Lancez-vous dans une nouvelle aventure avec DoingBuzz
Découvrez une multitude d'offres d'emploi et de bourses d'études adaptées à votre parcours.
Newsletter
Abonnez-vous et accédez à tous nos articles en premier !